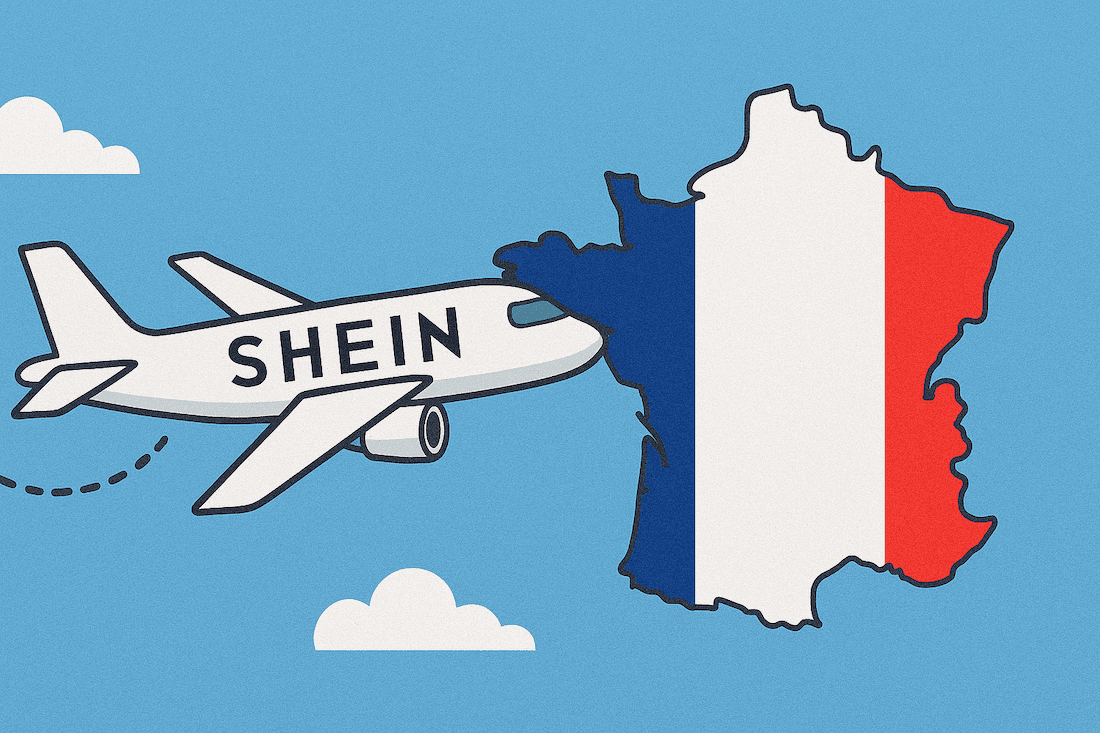Une ascension mondiale opaque aux racines chinoises
Shein a été fondée en 2008 par Xu Yangtian, également connu sous le nom de Chris Xu.
Originaire de Chine, l’entreprise s’est d’abord spécialisée dans la vente en ligne de robes de mariée avant de pivoter vers la fast fashion.
Dès ses débuts, la marque adopte un modèle agressif basé sur l’optimisation algorithmique de la demande, la réduction extrême des coûts de production, et une chaîne logistique centralisée.
La stratégie repose sur une production à la demande : une première série de quelques dizaines d’unités est lancée.
Si elle fonctionne, la production est alors massifiée dans un délai de quelques jours.
Ce fonctionnement permet à Shein de proposer jusqu’à 10 000 nouveaux produits par jour.
La société, bien que chinoise à l’origine, a depuis transféré sa domiciliation juridique à Singapour, sous la société Roadget Business Pte Ltd.
Cette structure lui permet d’échapper à certaines régulations chinoises et de bénéficier d’un environnement fiscal plus favorable.
lle opère via des dizaines de filiales aux noms changeants, rendant toute tentative de suivi institutionnel extrêmement complexe.
Shein en France : du numérique au physique
La marque débarque en France au début des années 2010 par le biais de sa boutique en ligne.
Très vite, elle s’impose dans le paysage digital avec des prix défiant toute concurrence et un marketing ultra-ciblé sur les réseaux sociaux.
Les jeunes, principalement les femmes entre 15 et 30 ans, deviennent le cœur de cible.
Grâce à des promotions permanentes, une présence massive sur TikTok et Instagram, et le recours à des micro-influenceurs, Shein s’impose comme une référence de la mode accessible.
Pendant plusieurs années, l’entreprise n’a aucune présence physique.
En 2023 et 2024, elle multiplie les boutiques éphémères dans les grandes villes françaises.
Mais c’est en 2025 que le basculement opère : Shein annonce l’ouverture de ses premiers points de vente permanents en France.
La marque intègre notamment des espaces dans des enseignes emblématiques du commerce français comme les Galeries Lafayette ou le BHV.
Cette nouvelle étape déclenche une onde de choc dans les milieux économiques, politiques et artisanaux.
Le scandale d’un modèle économique jugé toxique
L’arrivée de Shein dans le commerce physique français est perçue comme une attaque frontale contre tout un écosystème.
Les artisans, créateurs indépendants, petites marques et industries du textile dénoncent un modèle de prédation économique.
Produits à bas prix, qualité souvent contestée, conditions de travail troubles chez les fournisseurs, cycles de consommation effrénés : autant d’éléments qui nourrissent la polémique.
Shein est accusée de menacer directement le tissu industriel français, déjà fragilisé par des décennies de délocalisation.
De nombreux ateliers textiles ferment ou réduisent leurs effectifs, incapables de suivre la guerre des prix imposée par l’enseigne.
Le modèle Shein repose sur l’exploitation massive d’usines en Chine ou dans des zones à très bas coût, où les droits sociaux sont souvent inexistants.
Des enquêtes ont révélé des cadences infernales, des salaires inférieurs aux minima légaux, et une absence totale de couverture sociale.
L’empreinte écologique est également dénoncée : matières synthétiques, surproduction, transport international, déchets non traités.
Les ONG environnementales parlent d’un désastre climatique maquillé sous des campagnes marketing dites “écoresponsables”.
La marque revendique des engagements “durables”, mais ne publie aucun rapport indépendant sur ses émissions ou sa traçabilité.
Un empire sans visage : qui tire les ficelles ?
Shein est un groupe dont la structure de propriété reste largement opaque.
Aucune cotation en Bourse. Aucun siège clairement identifiable sur le territoire européen.
Le fondateur, Chris Xu, cultive une discrétion rare dans l’industrie du textile.
L’entreprise fonctionne comme une galaxie de sociétés interconnectées, réparties entre la Chine, Singapour, Hong Kong, et parfois même l’Irlande pour ses services financiers.
Cette structuration permet une évasion fiscale de grande ampleur.
Peu de taxes sont payées en France malgré les millions d’euros générés par les ventes.
La logistique est sous-traitée à des géants du transport, comme DHL ou SF Express.
Les partenaires logistiques français, eux, ne perçoivent que des marges dérisoires.
En revanche, les grands magasins qui accueillent Shein bénéficient de nouveaux flux de visiteurs, ce qui relance leur fréquentation en berne.
Ces enseignes justifient leur choix par la nécessité de “s’adapter aux attentes des jeunes consommateurs”.
Mais ce partenariat avec une marque controversée fragilise leur image auprès de certains clients attachés à l’éthique ou au made in France.
Réactions politiques : entre indignation et inertie
Face à l’implantation de Shein, plusieurs députés appellent à une loi encadrant les pratiques de la fast fashion.
Ils demandent un moratoire sur l’ouverture de nouveaux magasins, une taxation spécifique pour les articles importés à bas prix, ou encore l’obligation d’afficher l’empreinte carbone des produits. La DGCCRF a ouvert une enquête en 2024 sur les pratiques commerciales de la marque.
Elle conclut à des “réductions fictives”, “des prix de référence artificiels” et “une opacité sur les conditions de production”.
Une amende de 40 millions d’euros est infligée en 2025.
Mais cette somme reste insignifiante à l’échelle d’un groupe qui génère plusieurs milliards de chiffre d’affaires mondial.
Du côté de l’Élysée et de Bercy, les réactions sont prudentes.
Personne ne veut risquer un conflit diplomatique avec la Chine ou compromettre des accords de libre-échange.
Les institutions européennes tentent d’imposer des standards de traçabilité.
Mais la régulation reste lente, et Shein continue de profiter des failles du système douanier.
Les conséquences pour l’économie et le tissu social
Le cas Shein révèle toutes les failles de la mondialisation actuelle.
Le consommateur est piégé entre son pouvoir d’achat limité et la tentation de vêtements à 5 euros.
Les marques éthiques, locales, responsables n’arrivent plus à suivre.
Elles ferment, licencient, se replient sur des marchés de niche.
Les centres de formation aux métiers du textile constatent une chute des inscriptions.
Les jeunes ne voient plus d’avenir dans un secteur dominé par des géants opaques et déconnectés de toute logique locale.
Les territoires ruraux, qui abritaient encore des ateliers, perdent leur dernier poumon économique.
On assiste à une véritable désindustrialisation textile de proximité, accélérée par l’irruption de ce mastodonte numérique et physique.
Vers un réveil collectif ou un abandon programmé ?
Face à ce séisme, plusieurs voix appellent à une réaction ferme.
Créer un label textile obligatoire incluant origine, empreinte carbone, et respect social.
Réguler la publicité sur les plateformes des marques qui ne respectent pas ces critères.
Soutenir financièrement les créateurs français pour rétablir une forme de justice commerciale.
Imposer des droits de douane proportionnés à la distance de production et à l’impact environnemental.
Mais la bataille s’annonce difficile. Le lobbying de Shein à Bruxelles comme à Paris est actif.
La marque investit massivement dans son image, sponsorise des événements culturels, et tente de se rapprocher de certaines institutions locales.
Le risque est clair : banaliser l’inacceptable sous prétexte de croissance ou d’adaptation au marché.
Ce débat dépasse la mode.
Il interroge nos choix collectifs, notre vision de la consommation, notre rapport au travail, au local, et à l’environnement.